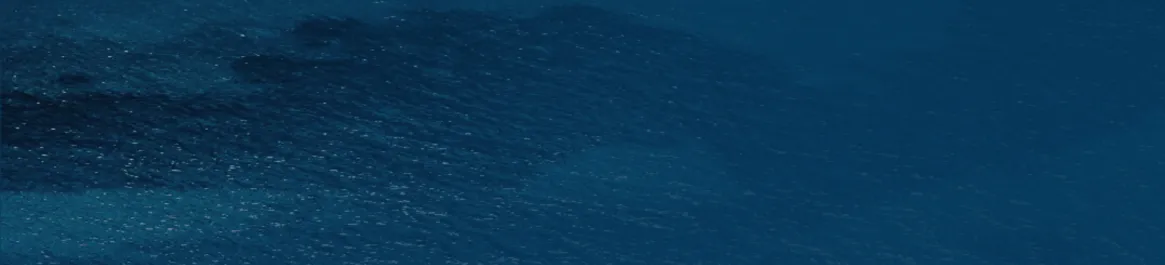
Deskiñ ha Komz Brezhoneg


Quelques Traits de la Toponymie Maritime de la Cornouaille Britannique

Paul QUENTEL (article écrit en 1950)
Extrait des "Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest Année 1950 57-2 pp. 199-208"
Les cartes principalement utilisées ont été : les cartes marines françaises du Lizard (1865); des Scilly (1869);
Carte Land's end and Lizard de l'Ordnance Survey of G. B., n° 146.
Le lien suivant permet de "zoomer" sur les zones traitées dans l'article : Carte Nautique GB
• Observations générales
On sait que le Service hydrographique de la Marine française a entrepris la mise à jour des cartes marines de Basse- Bretagne.
C'est ce travail qui a suggéré cette petite étude de toponymie cornique.
De toutes les langues celtiques, c'est le cornique, ou langue de Cornouaille qui se rapproche le plus du breton.
Mais le cornique s'est éteint au XVIIIème, et beaucoup de noms de lieu ont été soit complètement remplacés par des noms anglais,
soit notablement altérés par un peuple qui ne comprenait plus le cornique.
Ceci est peut-être plus marqué encore en toponymie maritime qu'en toponymie générale, du fait de l'occupation des îles
par des étrangers à la Cornouaille.
C'est ainsi que «Poldu, la mare noire,» est tantôt écrit «Poldhu, Poldew» et, sur certaines cartes, «Poljew»
(le son «ü» du cornique, français u, n'est pas anglais).
Le son «i» de crib est souvent représenté par "ee" ou par "e".
La gutturale «ch» du gallois, breton "c'h", est écrite tantôt "ck" (Manack, point près de Porthgwarra), tantôt "ch" : minich, pluriel du précédent, dans les îles. Sur certaines cartes on lit Prah sands, à l'Est de Porthleven, sur d'autres Praa sands.
Souvent le son ch n'est pas représenté ; il y a plusieurs toponymes
The Wra, la sorcière, breton Gwrac'h ;
Loo, looe, loe représentent le breton loc'h, gallois llwch.
Il est possible du reste que ce son ne fût plus prononcé, au moins en finale, au XVIIème siècle, dans une partie de la Cornouaille (A Theix, dans le Vannetais, on dit bré pour brec'h) ;
De même le th représentant le th doux anglais n'est pas toujours noté.
On trouvera quelquefois « por pour porth » et généralement « mené pour meneth, montagne.»
L'orthographe est cependant souvent plus conservatrice que la langue parlée :
Treryn, par ex., est prononcé tr:in.
Trereife, près de Penzance : tr:iv.
Dans les nombreux toponymes hybrides anglo-corniques, on trouve quelquefois un adjectif anglais après un nom cornique, ce qui fait penser que l'adjectif a été traduit, puisqu'en cornique, comme en breton, l'adjectif se place après le nom (1), c'est le cas, par exemple de Carn Irish.
D'autre fois, au contraire, l'ordre de deux composants corniques d'un toponyme trahit une influence anglaise, on trouve :
Mawgan porth sur certaines cartes (type anglais : St-Peter's port) et Porth Mawgan sur d'autres.
Les toponymes anglais nouveaux calquent quelquefois phonétiquement les toponymes corniques. Au Lizard, un toponyme « man o’ war » s'est substitué à un toponyme cornique « menanvawr »
(la grande roche) (Black' s guide of Cornwall, s. v. Lizard), et telle est sans doute l'histoire d'un autre « man o' war », à Saint Ives. C'est ce qui s'est passé pour les deux montagnes de Galles du Nord « Yr eitl », les fourches (prononcé : Reivl), dont les Anglais ont fait « The Rivals » (Raivls) « les rivales ».
On pourrait citer de nombreux faits similaires en Bretagne : Portz mer, à Cancale, est certainement Porz meur « le grand port », mais l'adjectif est pris pour le subst. français mer, à St-Brieuc, les Rosaires ont certainement remplacé « Ar Rozeier » les promontoires. Ces faits, qui se sont généralisés en Cornouaille britannique expliquent la raison pour laquelle nous ne cherchons à interpréter la toponymie maritime du pays que dans ses grandes lignes et en nous bornant aux principaux éléments de la topographie.
(1) La règle, cependant, n'est pas absolue, surtout dans les toponymes les plus anciens.
• Les Iles
Enys ynys, innis, mot fém., est le terme cornique qui désigne une île, en irlandais innis, en gallois ynys, en breton enez. Enys remonte à un celtique iniss-i, apparenté au latin insula. (V. Henry, Lexiq. étym., 114.)
Beaucoup de petites îles sont appelées enys ou « the enys », sans autre déterminatif : Ynys, Mount's bay ;
« the enys », Ouest de Morvah ; do, Prussia Cove, etc...
Pen ynys, Pen innis, à St-Mary's, désignent le bout de l'île.
Innisidgen, Nord de St-Mary's « l'île de l'oiseau » ;
Innis vouls, Est de St-Martin's « l'île au mouton ».
Dans les noms des îles plus importantes, le terme enys n'est pas mentionné :
Mouls, le mouton ;
Bryer, de bri, hauteur ;
beaucoup portent des noms de saints : Saint-Agnes, St-Mary, etc…
On sait qu'en breton enez(enn) ne désigne pas seulement « une terre entourée d'eau », mais aussi, par ex., un lieu sur les rives d'une rivière.
Le fait est général en celtique. Loth cite un exemple cornique (Revue celt., XLVI, 161 sq.),
Molinnis, dans les terres. De même en irlandais. Joyce (Irish names of places, Dublin 1887, I, 441)
note à propos de innis que « it is also applied in ail parts of Ireland to the holm, or low flat meadow along a river ».
Ifor Williams (Enwau llcoedd, Lerpwl, 1945) relève de même, p. 29 sq., des faits semblables en gallois et rapproche l'évolution du latin insula.
• LES PORTS
Porth, m., emprunt au latin portus, gallois id., breton porz, est un terme générique très largement représenté. On trouve aussi por, et, dans certains toponymes, seul subsiste le p initial. Porth ne désigne pas seulement un port, au sens anglais du terme, mais une petite crique, une baie. Sa ressemblance sémantique et phonétique avec l'anglais port, également de portus (1) a certainement contribué à maintenir le terme.
On trouve, entre autres :
Port Mawgan ; Porth Leven ;Perranporth - noms de Saints : le dernier est St Piran.
Porth Cressa, à St-Mary’s « le port (le plus) central » ;
Porthscatha, le port des bateaux ;
Porthloggos, le port des souris (cf. le toponyme anglais Mousehole, à St Paul) ;
Porthquin, le port blanc (2) ;
Porthbean, le petit port ;
Pelistry, le port aux navires
(1) Le vieil anglais avait également port dans le sens de « ville avec droit de marché» : cf. les nombreux « Newport », souvent dans les terres.
• PROMONTOIRES, TERTRES, EMINENCES
Ros n'est curieusement rendu dans Williams {Lexicon cornu-brittanicum) que par « moor, mountain meadow, common ».
V. Henry (Lexiq. étym., 235) rattache ros « à un celtique rosto pour pro-st-o, « qui prédomine », composé de pro et de STA ».
Cette étymologie paraît satisfaisante, et l'on rattache à cette même racine STA l'allemand Gestade, rivage, Klüge (Ety. Wort.).
Le premier sens de ros paraît bien être celui de promontoire, puis, par extension, celui de tertre. Ifor Williams (opus. cit., 23) ne rend le gallois rhos que par hauteur : mais Penrhos et Rhoscolyn, par exemple, à Holyhead, sont bien des promontoires. Le breton ros a bien ce sens aussi (3).
En cornique, ros désigne un « promontaire » à Rosemullion, Falmouth bay (mullion désigne le trèfle) ;
« un tertre » dans Rosevear « le grand tertre », Rosevean le petit tertre, Sud Ouest d'Annet.
Rhyn, comme l'irlandais rinn, « denotes a point of land, a promontory or small peninsula » (Joyce, opus. cit., 405).
On le trouve dans Penrhyn, près de Falmouth.
Ban, hauteur, mont, qui appartient à la toponymie générale du pays (en composition habituellement ben, cf. Venwyn, La hauteur blanche, au XIII siècle Bynwyn, Nance, Cornish English dict., s.v. ; et, en Bretagne, Ben Odet), est employé une fois pour désigner une hauteur en mer constituant une île.
Mene(th), montagne : une petite île, au sommet très élevé à l'E. de St-Martin, est appelé menewethan.
(2)Le cornique a conservé la différence de genre dans l'adjectif : Gwyn est le masculin. (3)Ce terme subsiste dans la toponymie anglaise : Ross (Northumberland), Roos (Yorkshire) sont près de promontoires.
• LES POINTES, EXTRÉMITÉS
Pen (pedn, peden), gallois pen, breton penn, pointe extrémité, désigne un point avancé sur la côte, ou simplement une extrémité.
Pentire, l'extrémité de la terre, au large de New-Quay ;
Pedn bean (île Tean) , la petite pointe ;
Peden mean du, l'extrémité de la terre noire, Land's end, etc...
• DUNES
Towan, d'une racine *teva — qui signifie « s'enfler », élargie avec suffixe — en (Strachan, Bezzenibergers Beitrage, XVII, 301; Vendryès, Miscellany presented to Kuno Meyer, 288; J. Loth, Revue celtiq., XLI, 406),
gallois tywyn, breton tevenn, désigne la dune et, par extension, une rive sablonneuse.
Towan bay, Towan head, près de New-Quay ;
Porth Towan ; Pen tewan.
• GROTTES, CAVITÉS DANS LES ROCHES
Zawn désigne une profonde cavité dans les roches du rivage. C'est le même terme que stefenic du vocabulaire cornique, traduit par palatum (de même en breton, san, conduit d'eau ; staon, palais de la bouche ; mais vannetais san, palais ; sur l'alternance s et st, cf. Pedersen, Vgl. Gr. 1,78).
Le terme Zawn est largement représenté : Zawn a Bal, Wheal Edward Zawn, Levant Zawn, Trewellard Zawn, Oreat Zawn, entre Cape Cornwall et Gurnard's head. Il y en a plusieurs autres.
Ce terme est aujourd'hui encore courant dans l'anglais de Cornouaille.
• LE SABLE, LA GRÈVE
Treth, traith, treath, emprunt au latin tractus, breton trez, treaz..., désigne le sable courant et quelquefois par extension, comme en breton, la grève.
Pentreath beach, au Lizard ;
on le retrouve dans Luitreth (en mer, dépassant de 0 m. 2 à 3m.),
au Sud Ouest. d'Annet « Le sable gris; ».
Growan (grou du vocab. corniq., traduit harena) est encore aujourd'hui employé pour désigner du gros sable (Black's Guide to Cornwall, 95), mais ne semble guère avoir été employé dans la toponymie cornique
• ROCHES ET PIERRES ISOLÉES
Men, maen, mean (et probablement menan, min), pi. myin (min?),
breton men, maen, pluriel. mein, désigne une roche ou une pierre.
Minmow, men pingrim (île Annet).
Menglow, St-Agnes.
Peden mean du, Land's end « Le bout de la pierre noire ».
Tal y maen « Le sommet de la pierre » (cf. : tal an chy, Lhwyd, Archae,, 252) (1).
L'adjectif correspondant est :
Meinek (Longship) ; vyyneck, Ouest de Pte de Penzance.
• LES BASSES
L'adjectif bas, baze, lieu peu élevé, emprunt au latin basus, que l'on retrouve dans toutes les langues celtiques, est relevé dans les dict. corniques avec le sens de « shallow ».
A Penberth : Dowrow base;
dans les Scilly : Cam top et Carn base.
(1) L'article y est curieux. L'orthographe a dû être influencée ici par la forme galloise de l'article
• GROSSES ROCHES, RÉCIFS, ÉCUEILS
Carrag, carrick, carrack, breton karreg, gallois carreg, irl. et gaeliq. carraig, d'une racine i. e. KARS qui signifie dur (V. Henry, Lexiq., 55 ) désigne une grosse roche, particulièrement en mer, un récif, un écueil.
Le breton karreg a le même sens, de même que le gallois carreg, en toponymie du moins, car dans la langue courante carreg désigne aujourd'hui même une petite pierre, un caillou.
On trouve en cornique :
Carrickstarne, Sud de St-Mary's;
The Carracks, Ouest de St-Ives;
Carrick lûz, la roche grise (Kerreg lûz en kuz est l'ancien nom du mont Saint-Michael) ;
Carricknath, près de St-Mawes.
Cragg, doublet étymologique de carrag (de même gallois carreg + crag ;
irlandais carraig + craig. )
L'anglais a emprunté le terme au celtique et l'emploie dans la langue courante.
Se retrouve dans :
Craggan rocks, Cap Lizard.
Craggyellis, Est de l'île Tresco.
• AMAS DE ROCHES, MONTS ROCAILLEUX, ROCHES
Carn, également de *KARS.
gallois carn, breton karn, irl. et gael. cairn, désigne une masse de rochers, et exceptionnellement une très grosse roche. Ces masses de rochers sont souvent recouvertes de terre et de quelque végétation, ce qui explique des toponymes du genre Carn voel « Le mont (rocailleux) dénudé ».
Carn mellyn, Land's end, « les roches jaunes » ;
Carn Irish, île Annet; Carn voeL, Land's end; Carn du, les roches noires, près de St-Michael ;
Carn barges « Les roches au busard »;
Carn scathe, les roches au bateau;
Carn leskys, près de St-Just, « Les roches brûlées » (1).
Carnellow, Ouest de St-Ives, semble être le diminutif pluriel : « les petits monts ». Le type carn est très largement représenté dans la toponymie de la Cornouaille britannique. Ici encore, il faut rappeler que le terme est compris des anglophones puisque l'anglais a adopté cairn, emprunté au gaélique. Le terme est moins courant en Bretagne : beaucoup des carnow de Cornouaille seraient en Bretagne des reier.
Mais c'est ce même terme que l'on trouve dans les toponymes Ile Carne, côte Nord de Bretagne ;
île Carnay (Loire-Inf.) ;
Pengarne, île Saint-Michel (Loire-Inf.) ;
Carnac ;
Pozcarn (Penmarc'h) ;
Le « grand Harn », etc…
• ROCHES ABRUPTES FALAISES
Clog, irlandais cloch, très courant dans les noms de lieu en Irlande, Joyce, opus. cit., 413, gallois clog, est traduit dans les dictionnaires corniques « steep rock ».
Il y a, à l’Ouest de St-Ives, un « clodgy point », et par ailleurs un « carn clog ».
Cligger, cligga, cleghar, clicker est un dérivé du premier. « Megiliggar rocks » Ouest de Porth Leven est probablement pour « myncleghar ».
Le terme est aussi courant dans les terres (1).
Klog est breton et se trouve dans le terme qui désigne le crâne klopenn, en gallois penglog. Il semble peu courant en toponymie, mais la « pointe de Clocdeneu », au Sud de la Bretagne, comprend certainement ce mot.
Pour son dérivé Kleger, cf. Cuillandre, Toponymie de L’archipel Ouessant- Molène, 22.
(1) L'une de ces roches «Clicker tor», à St-Germaris, est décrite dans Black's Guide, 54, « a rough height of serpentine rock covered with heath and fern »
• ARÊTES ROCHEUSES
Crïb, fém. (Creeb, Creb, Greeb, Greb), désigne une arête de roche ou de montagne, des roches longues, généralement peu élevées et découpées.
On dit « crib an ty », the ridge of the house (Lhwyd. Arch., 53), comme en gallois « crib y ty ». Le vieil irlandais crich, qui a le sens de limite, et qui correspond phonétiquement à crib, semble avoir surpris V. Henry (Lexiq., 81).
Mais les deux représentations s'expliquent aisément : ce qui forme arête peut séparer et former limite. De nombreuses roches sont désignées par le mot crib, seul ou en composition : The Greeb, près du Mt St-Michael, Little Greeb, Orebawethan, Ile Annet; Greeb Point, Est de Falmouth ;
Little creeb, Ouest de St-Mary's (4 mètres 6) ;
Gribben head, près de Fowey.
Krib est également employé en toponymie maritime bretonne, avec le même sens.
Son dérivé krïbell est plus employé pour désigner une arête de montagne, ou la crête des vagues.
Il existe un doublet cornique de crib qui est crim de même en gallois : crim, (a ridge, dict. d'O. Pughe.)
Crimog a, comme Kribell ou kribenn en breton, le sens de « tibia », c'est-à-dire « l'arête de la jambe ».
Crim rocks, extrême Ouest d'Annet ; men pigrim, Annet.
Cribin, autre dérivé (racine élargie en -n), doit avoir le sens du breton kribin, carde, et désigner aussi tout instrument à pointes (« ar maro var ar c'hrill e kreiz an tan... dre ar c'hribinou houarn — , Feiz ha Breiz, 1872, 181 a, 12).
Son adjectif est représenté dans le nom d'un îlot à l'extrême Ouest des Scilly crebinicks.
En Bretagne, les roches « kribinok » sont peu élevées, en forme d'arêtes, dangereuses pour la navigation.
Il y a aussi un toponyme Kribinek sur une rive de l'Elorn.
• ROCHES POINTUES
Un certain nombre de roches effilées et pointues sont appelées « biggal » dans les Scilly. C'est un dérivé de pic, breton pik, en qui V. Henry; Lexiq., 223 voit un emprunt français (on pense plutôt au latin pic-en). « Biggal » est soit un petit pic, soit la pioche (breton picell). II y a du reste au Sud de Seal Bock un « picket rock »r toponyme anglais, « la pioche ».
• AUTRES ROCHES, POINTES, ILES
Certains rochers et certaines pointes, de même que certaines îles, ne sont pas dénommés par un terme générique, mais par un nom d'animal ou de personne, ou par un adjectif
Voici quelques-uns de ces noms :
Ebat, Ouest de Zennor, roche, « Le poulain » ;
The Wra, au large de Morvah, « la sorcière » ;
The bodnick, à St-Mary's, « la touffue » ;
Spernic, entre Black Head et Lizard, « l'épineuse »
(il y a une pointe « spernic » en Bretagne, à Portivi).
Beaucoup de points de la côte portent des noms corniques de localités voisines, dans les terres, suivis d'un mot générique anglais :
Predannack Head, Pennance Point, etc…
Les toponymes qui semblent rappeler la contrebande, courante pendant plusieurs siècles, avec la côte bretonne, notamment avec la région de Roscoff (sur cette question, cf. A. K. Hamilton Jenkin, (Jornwall and Us people, Lon- don 1932, p. 9, p. 22, p. 29, p. 33), sont anglais : Frenchman's cove, etc…
de même que ceux comme les « Spanish ledges », dans le St-Mary's Sound, qui paraissent être des souvenirs des combats de 1595 lors desquels Penzance fut mise à sac par les Espagnols
La publication prochaine, par L’English place name Society (EPNS)d'un ouvrage de toponymie générale de Cornouaille permettra certainement de mieux connaître la toponymie maritime du comté qui s'apparente étroitement à celle de Bretagne.
Paul QUENTEL
Né en 1911 à Cléder, décédé à Brest en 1989
Professeur d'Anglais, contributeur aux Annales de Bretagne & Etudes Celtiques
Autres noms : Paol Kentel, Goulc'hen ar Pagan